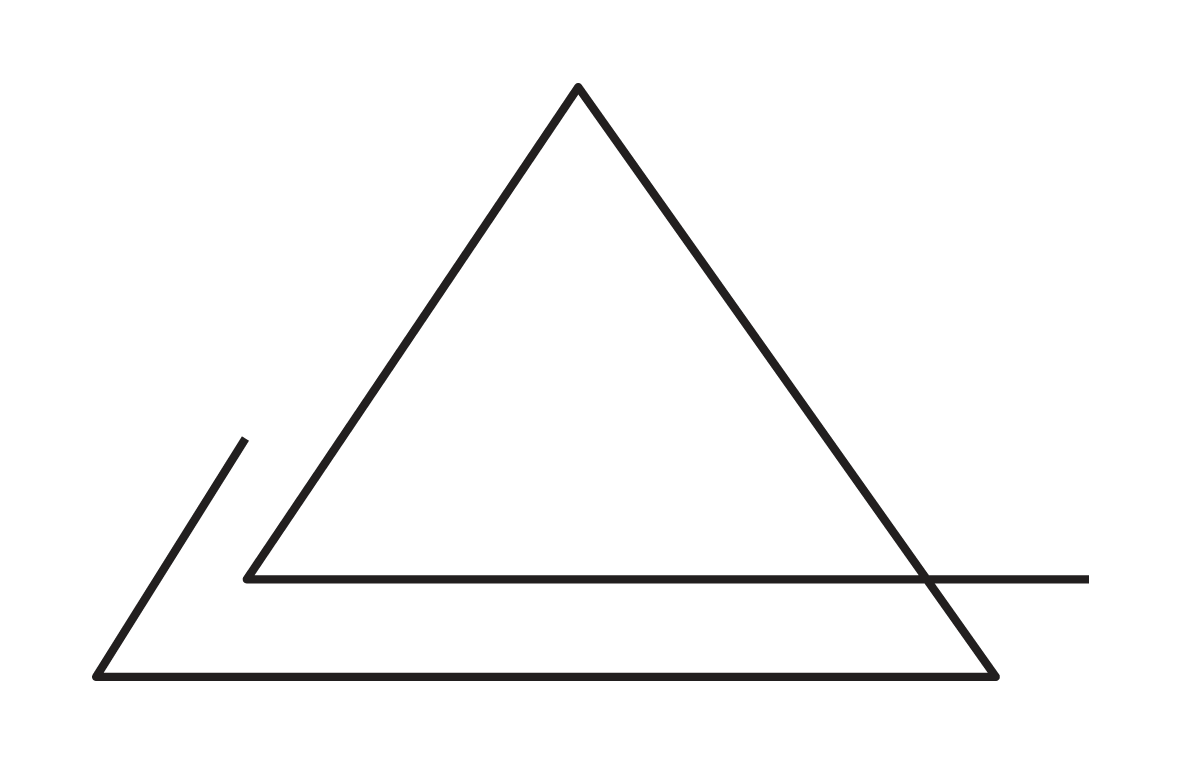Apatrides
– Vous avez un passeport diplomatique?
– Ah non mais je suis membre d’équipage sur Maewan IV
– Ah d’accord passez je vous en prie
Un coup d’œil à mon téléphone, Il est 13h à Santiago du Chili et je viens de passer 5h dans la queue des services sanitaires pour expliquer dans mon meilleur espagnol, riche de 30 mots et 3 verbes, que je vais rejoindre à titre bénévole en tant qu’expert indispensable de la mer et surtout de la montagne, Erwan mon capitaine et Alex mon copain vicomte et ex guide de haute montagne pour une mission dans l’Atlantique Sud d’un mois en partance imminente pour le Brésil. Je n’ai donc ni le temps ni l’humeur de m’astreindre à cette quarantaine annoncée. Le fournisseur local s’affiche sur mon téléphone avec une puissance maximale mais sous un nom incongru : « quedate en casa ». Quedate en casa ça ne veut pas dire restez à la maison ça? Pour ma part c’est un peu tard pour suivre ce conseil gouvernemental, je suis déjà parti. Je lance un texto à mon cousin qui habite ici avec sa famille : tu peux ouvrir les huîtres, j’arrive. Je suis seul sur la route, seul dans un taxi. Des flics grouillent et arrêtent des gens. La ville est méconnaissable. Un texto réponse de mon cousin s’affiche : trop content de te voir mais comment as-tu fais ? Ils parlent de fermer totalement les frontières dans quelques jours…

Punta arenas, joli port de Pêche. Ma dernière visite ici remonte à 2019 en partance pour une expédition de 7 semaines en antarctique dans la région du mont Vinson. Aujourd’hui tout a changé et j’ouvre avec ce voyage une parenthèse sur le monde qui entre temps à disparu sous un masque de brume covidien. J’ouvre aussi une parenthèse sur ma vie d’alpiniste et de père de famille pour devenir matelot. Riche de mes deux semaines d’optimiste à Benodet il y a 35 ans, je cherche à rafraîchir mes connaissances de marin d’eau douce par un petit stage dans les cinquantièmes rugissants. Certes le bateau je le connais, c’est moi qui l’ai acheté ! Enfin je veux dire, j’étais avec Erwan dans le port de Honfleur il y a six ans de cela lorsque nous avons visité la bête moisissant sur cale et que mon pote en me regardant m’a dit : il a l’air pas mal hein? Depuis Maewan IV a fait les trois quarts du globe mais sans moi. Six ans que les plans échafaudés pour partir dans le ventre de ce rafiot en Alu, se heurtent à une vie trop remplie et 6 ans que je le suis des yeux et du cœur sans pouvoir vomir une seule fois au bastingage.
Ce matin j’exhausse mon rêve. La houle cette nuit s’est levée dans le port de Punta arenas. Nous sommes peu protégés du vent et des vagues et les gros bateaux bleus de pêche aux oursins, trop serrés les uns aux autres ont joué aux quilles dangereusement arrachant des portiques et frappant leurs grosses coques sur le frêle et unique voilier de la région. Une bouffée de chaleur me monte et la bile est au bord des lèvres. « Pas encore pris la mer et déjà malade, ça promet… » Je grimpe sur le pont pour tenter de reprendre le dessus. A quelques mètres de Maewan les vagues déferlent. « On installe des amarres en doubles que l’on puisse larguer en deux secondes et on y va! » La voix d’Erwan résonne comme un mauvais rêve. Si on se rate, le rivage est à 40 mètres. Autant dire que la marge est faible. L’amarre de proue reste coincée chez notre voisin pêcheur mis à couple. Dans 30 secondes il sera trop tard. Avec Alex nous secouons comme un prunier cette foutue amarre. « Ca y’est, c’est bon! » Erwan met les gaz sur la première vague et nous attaquons la barrière d’eau de face. Erwan me crie: « Sam prend la barre, il faut que je m’occupe du reste… » Le voilier fait le bouchon et je me contente de suivre la danse. Je n’ai plus le temps pour vomir, on verra plus tard. « Cap au nord ouest pour le détroit de Magellan mais toujours au moteur s’il vous plait, on est vent de face. » Des dauphins noirs et blancs nous escortent jusqu’à la sortie des canaux et une baleine passe nous saluer quelques instants.


En traversée les jours et les nuits s’enfilent comme les perles d’un même collier. Après plusieurs jours de navigation, j’ai déjà l’impression d’avoir vécu dix vies mais sur une seule journée. Elle a commencé au port de Punta Arenas et finira en terre promise paraît-il. Le Brésil, c’est dans 2000 miles. Après un dédale de plateformes pétrolières et de tankers de 200m de long qui croisent notre route, l’heure est aux voiles. Nous hissons. La magie d’Éole drape le voyage par son bruissement et sa force mais en un clin d’œil la piscine tranquille des canaux se transforme en océan féroce. Creux, vagues croisées des hauts fonds et vent parfois à 30 nœuds, change le territoire. Je suis sidéré par la quantité de bruits différents qui sonnent à mes oreilles. Le plus beau, reste celui de l’eau et de l’air qui s’écoulent sur l’avant de la coque comme un robinet musical. Le pilote automatique fait des siennes. Plusieurs arrêts pour tenter de réparer cette foutue pompe, se soldent par des échecs. Le capitaine décide de le ménager et l’ambiance des quarts à la barre s’installe. C’est aussi l’heure de mes premiers surfs sur les vagues à bord d’un voilier : « J’adore ! ».
L’exercice périlleux de notre activité de marin est une simple translation de quelques mètres entre la couchette et le pont. Celle-ci dure toujours trop longtemps pour des moussaillons malades et le pire réside bien sur dans l’habillage. Bottes et tenues complètes qu’il faut mettre et enlever en déséquilibre le vomi au lèvres et la tête groggy, me font haïr la manœuvre.
La nuit à chaque rotation, nous nous croisons dans les couloirs sombres pour monter sur le pont où il fait six où huit degrés. Seule la lumière rouge du mat et de nos frontales indique encore qu’une vie subsiste à bord. Le rouge étant la seule lumière tolérée pour garder dilatées les pupilles du navigateur sans l’éblouir. Un grand coup de manivelle de winch dans les bas flancs de la coque, sonne la relève. Le vent s’intensifie et la Grand Voile est descendue. Seul génois et trinquette nous poussent quelque part.
En six jours nous avons parcouru mile miles soit la moitié de notre parcours prévu.

Malgré la gîte inconfortable et le bateau qui tape sur les vagues comme un tambour, la cuisine continue de fonctionner à plein régime. Le chef Erwan envoie cocotte minute et four, bourrés de recettes variées comme si nous étions au mouillage d’un lagon polynésien. Avez-vous dégusté un « asado » avec des frites alors que votre corps n’est stable qu’à 45 degrés de gîte ou encore allongé comme un vieux débris pour résister aux efforts centrifuges de la navigation au près coupler à un roulis et tangage digne des fêtes foraines ? Mais se nourrir est la clé surtout lorsqu’on s’amarine. Bien manger, ne pas avoir froid, dormir si possible et s’écouter quand les nausées commencent pour limiter les efforts. Toutes ces notions font partie du manuel du petit marin. Pour ce qui est des 15 bouteilles de rouges, 3 bouteilles de Pisco et les 60 bières avitaillées au chili, nous n’y avons pas encore touché. Au bout de huit jours, il semble qu’Alex et moi commençons à nouveau à dessiner quelques mouvements et raisonnements au bord de la cohérence mais sans notre capitaine, qui est de toutes les tâches, nous serions rapidement amenés à périr. Moi que l’on surnomme habituellement Duracell pour mon hyperactivité légendaire, je semble avoir mes piles en court-jus et bouffées par le sel!


Le son d’une amitié indéfectible avec les trois compères continue de battre son plein. A la moindre accalmie nous transformons le bateau en « dancefloor ». La nausée s’estompe et nous tapons dans le stock du rouge chilien. Comble du luxe, après 10 jours de survie et une odeur persistante d’animal en cage aux hublots scellés, nous parvenons à stopper le bateau pour un bain dans une piscine de 5000 de fond et quasi sans vague. La mer tropicale nous enveloppe de bonheur avec ses 20 degrés et son eau limpide qui tire sur le vert émeraude. Le bonheur ne dure qu’une trentaine de minute et nous chevauchons à nouveau les vagues et le vent qui a repris du poil de la bête.
L’Atlantique Sud, malgré son charme et notre chance de slalomer gracieusement entre les dépressions, n’en demeure pas moins toujours teigneux et viril. La navigation au près renforce la dégustation et la sauvagerie de cette traversée. Manger ou boire est une mission de tous les instants mais nous observons scrupuleusement notre capitaine fracasse pour éviter les bleus.
Après 16 jours à se faire secouer comme des pruniers nous apercevons la côte brésilienne dans un halo doré. Comme il est bon de distinguer de longues plages, des collines, un phare et quelques maisons à l’italienne juchées dans les arbres comme une saveur sucrée d’un retour à l’humain.
Après une vingtaine d’heures le long des côtes, nous profitons encore du calme et de la nature en mouillant pour la nuit dans la baie d’un petit village.
Un ancien avec son zodiac vient nous proposer le menu « boat service » de son restaurant. Nous dégustons de mauvais calamars et crevettes vingt fois réchauffées dans une huile poisseuse mais au goût si victorieux d’aborder heureux, cette nouvelle terre après le grand désert de nos vagues. Florianopolis.
Au matin sous un soleil de plomb, le béton d’une mégalopole nous rattrape avec violence et le passage de Maewan et de son mât à 4m sous les ponts de la ville pourrait s’apparenter à la découverte de HongKong version Portugaise!
Après le pont virement à bâbord pour la Marina digne d’un port new-yorkais, quelques voiliers se perdent dans une armada de yachts à moteurs. L’ambiance est emprunte de testostérone et d’argent facile et sent l’huile de monoï sur la croupe et le sein plastique de quelques starlettes en chaleur. Certes il fait 28 degrés. Un accueil sous masque noir des employés nous glace le sang. Bienvenue dans la réalité. Malgré le confinement total du pays, une chaleureuse pogne de quelques « voileux » du coin qui n’en reviennent pas de cette apparition, nous rassure quelque peu. Pour eux nous sommes comme un vaisseau fantôme qui, au travers du brouillard et des fermetures de toutes les nations, a fondu comme un fou brun en transperçant l’eau pour attraper sa pitance et faire fi de toute cette mascarade.
Ici aussi la ville déserte s’est éteinte et nous bataillons sidérés, pour trouver un plat et une bière à nous mettre dans le gosier. Pour Alex et moi ce temps de terre et d’urbanisation exubérante lance une sorte de résurrection face l’adversité de la mer.
Pour le capitaine Erwan toujours aux aguets des moindres bruits de son bateau, la ville possède trop de sons qui s’entrecroisent et fatiguent. Ses oreilles débordent de cette overdose sonore à la limite du supportable. Le weekend nous préserve des taches administratives et nous prenons les paddle boards pour explorer la petite île qui jouxte la marina. Malgré le mal de terre qui nous fait danser comme des culbutos au milieu de la forêt et des blocs de granit, nous enfilons nos chaussons pour une cession de bloc inattendue.
Apres 20 jours de stage de voile, les muscles dorment et la peau flétrie des doigts est molle comme du beurre mais les rires compense le reste.


Repartir d’ici n’est pas simple car en théorie, nous ne sommes jamais arrivés. Toutes les frontières terrestres et maritimes du Brésil ont été fermées et la seule porte d’entrée et de sortie du pays se situe à l’aéroport de Sao Polo. C’est de là que le pays filtre dans un trou de souris son flux avec l’extérieur. Nous serions donc logiquement refusés dans le pays et contraint de continuer notre route. Grace au soutient logistique local et de Marion et son équipe – la tour de contrôle de Maewan – la police maritime est occupée a inventer un nouveau document qui nous permettrait de transiter par la terre en convoi privé de Florianopolis à Sao Polo et de là un zinc pourrait peut-être nous embarquer pour Paris. Avec une batterie de deux tests PCR en l’espace de trois jours et une liasse de documents qui remplissent la table à carte du capitaine, Alex et moi partons finalement à minuit pour 12 heures de route et nous laissons seul Erwan qui doit avant son départ obligatoire, s’occuper de la bête.
La parenthèse se referme devant nos 3 sourires béats et nos regards au loin. Quelques oiseaux marins sur le ponton nous dévisagent et le vent se lève sur la baie. Nous ne somme pas des diplomates, justes des marins apatrides.